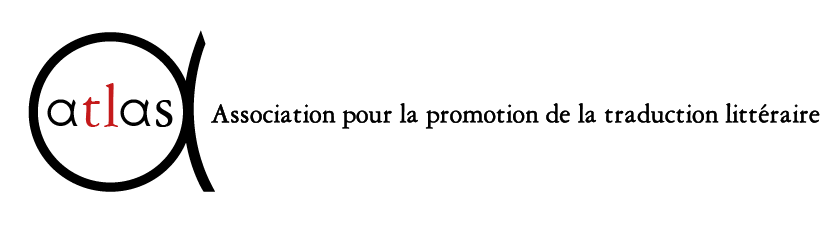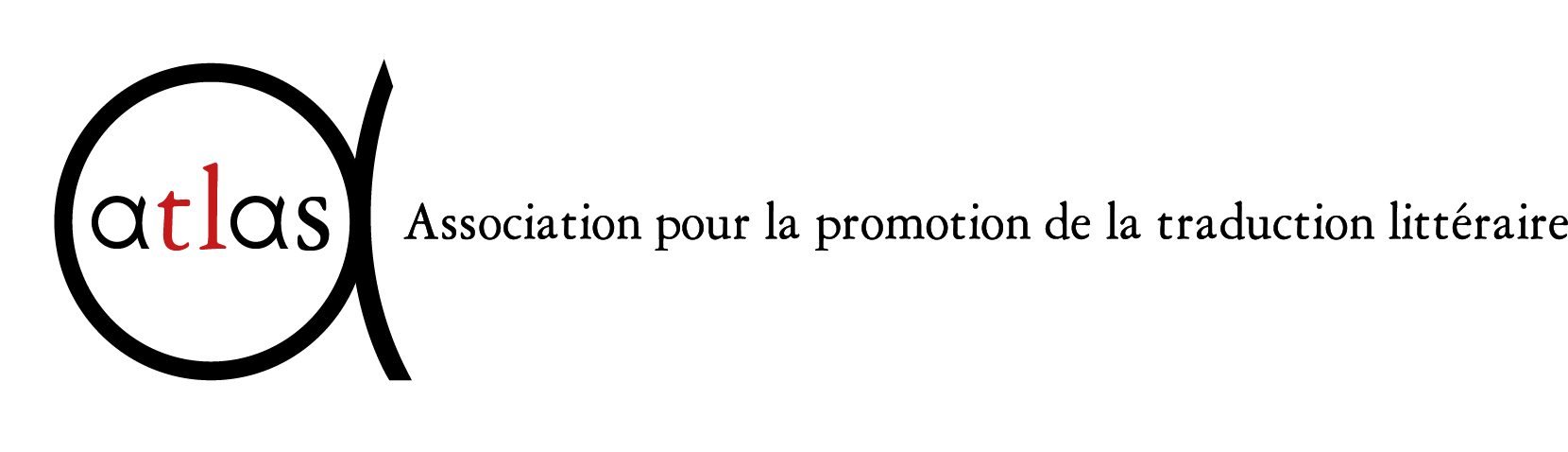Goûter les mots, oui, mais à quelle sauce ?
Goûter les mots, oui, mais à quelle sauce ?
Notre petite fabrique va bon train, la locomotive siffle, la maisonnée chantonne. Déménagement en vue en fin de semaine : aérien et insouciant, Zaïtsev monte au troisième, Koliada descend au rez-de-chaussée – espérons que le passage du camion matinal ne pousse pas Joulka dans les retranchements de sa folie – et Paule Constant s’isole (mais que trame-t-elle ?)
Trop terre-à-terre, ces préoccupations ? Que nenni, la traduction est certes un art, mais un art de vivre, et nous en avons eu une magnifique démonstration hier après-midi, par André Markowicz, traducteur de Dostoïevski, de Tchékhov et de Pouchkine. La vie, oui, la vie est au cœur du travail du traducteur : la technique est essentielle, mais seule, elle ne suffit pas. Autant un potier doit maîtriser les rudiments de son métier, connaître la bonne température de son four, savoir quelles couleurs mélanger pour obtenir les bonnes nuances sur l’argile, choisir ses pinceaux et son matériel, autant doit-il goûter la vie, laisser adhérer la terre à ses mains, voir et sentir, pour fabriquer ses objets. S’il ne fait qu’appliquer sa théorie à la lettre, personne ne pourra manger dans ses bols et ses assiettes, ni mettre de fleurs dans ses vases. Si le traducteur, à son tour, ne met pas la main à la pâte, ses textes, aussi inspirants, légers et riches qu’ils soient dans la version originale, resteront lettre morte dans la traduction. La glaise du traducteur, ses outils, ce sont les mots : il les mélange, les dilue, les cuit, les décore. Cela seul ne suffit pas encore : il doit leur insuffler un souffle de vie, une énergie vitale. Il doit faire vivre ses personnages, hurler ou chuchoter la voix du narrateur, transférer d’une langue à une autre odeurs, paysages, impressions, sentiments, sensations. Quoi de mieux, pour cela, que de se nourrir soi-même du tangible, du charnel, de revêtir l’habit du voyageur intempestif et de parcourir la vie à grandes enjambées de passions, d’amours et de haines, de dégoûts et de délectations ?
Le travail du traducteur est à bien des égards un travail de comédien. Entendez – le traducteur doit vivre et faire vivre son texte, l’accepter en son sein et le maîtriser, tout comme l’on attend d’un acteur qu’il sache trouver en lui toutes les cordes des passions humaines et les tendre sous le feu de la rampe au moyen de mimiques, de gestes, de mouvements du corps et d’intonations diverses et variées. Et plus elles sont variées, mieux c’est. Ce n’est pas une perfection que l’on recherche ici, mais une efficacité : l’effet d’une mise en scène au théâtre, le plaisir du texte à la lecture. Et tout comme le théâtre a ses ficelles qu’il s’applique la plupart du temps à cacher dans les coulisses de la représentation, tout texte est tissé de lignes – droites ou sinueuses – que le traducteur doit démêler dans l’original, pour les emmêler à l’identique dans la traduction. Lors du premier jet, le traducteur met le texte à nu, et ne l’habille qu’ensuite, empruntant à la langue et à la vie les habits qui lui siéent le plus, par couches successives, laissant dépasser çà et là un fil ou une bretelle, de quoi accrocher le regard sans toutefois dévoiler tous les secrets. C’est un grand travail de séduction.
On pourrait s’aventurer plus loin et dire que si une œuvre dramatique – même imprimée, publiée et lue – ne se déploie dans toute sa mesure que sur scène, un texte n’est jamais véritablement lu que par le traducteur. La traduction est une autre dimension de la lecture, toujours poussée plus avant, plus attentive. Elle remplit finalement cette fonction ultime de l’œuvre littéraire, qui est de conduire le lecteur vers le plus grand art de l’écriture.
Daria Sinichkina, 30 mai 2012