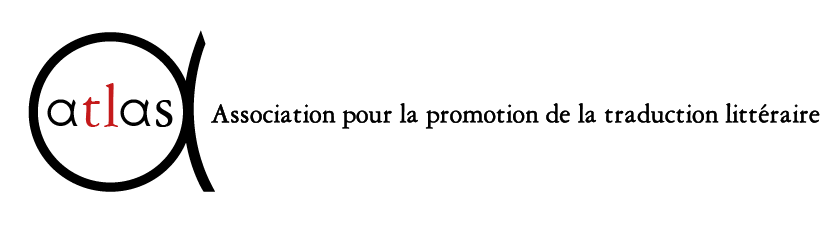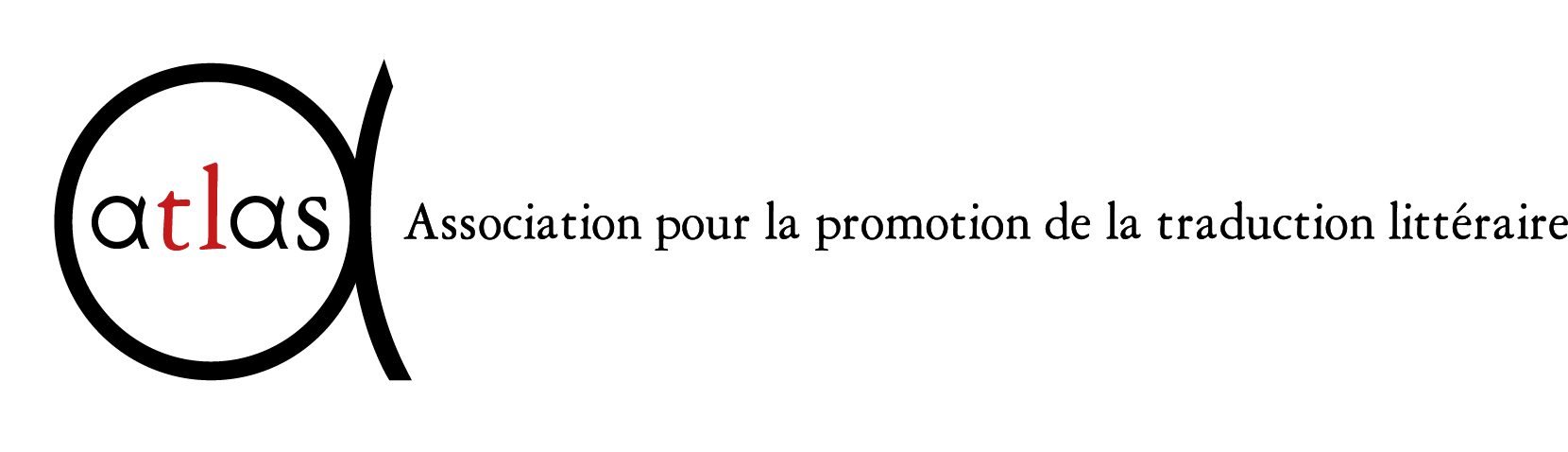OVNI littéraire, « monstre italien de plus d’un millier de pages », « Ulysse italien », « Moby Dick méditerranéen », les qualificatifs et comparaisons ne manquent pas pour définir le roman Horcynus Orca de l’auteur italien Stefano D’Arrigo. Monumentale fresque épique, poétique et métaphysique publiée dans sa version intégrale en 1975 et à laquelle l’auteur a travaillé près d’un quart de siècle, ce livre raconte pourtant une histoire simple : après l’Armistice, ’Ndrja Cambrìa, jeune marin italien, rentre chez lui en Sicile ; mais au centre du paysage crépusculaire qu’a façonné la guerre, dans le détroit de Messine, apparaît une nouvelle menace à la fois bien réelle et parfaitement allégorique : l’Orque, le monstre marin par excellence, qui donne son titre au roman. De cette trame s’engendre, telle une immense mer, un réseau complexe d’écritures marginales, de digressions sur l’histoire et la mémoire, et de réflexions sur le mythe et la légende.
C’est à ce chef-d’œuvre « pratiquement ignoré en Italie et inconnue à l’étranger », comme l’a déclaré George Steiner, qu’Antonio Werli, traducteur de l’italien et de l’espagnol actuellement en résidence au CITL, se consacre depuis déjà trois ans. Il en fera une lecture ce soir au CITL et nous a donné des nouvelles de ce voyage unique en traduction.
CITL : Antonio, vous lirez ce soir des passages extraits de la traduction française de la première moitié du roman Horcynus Orca, cette occasion de faire entendre votre traduction est-elle une première ?
A. W. : Non, c’est la deuxième fois, ici à Arles. La traduction vers le français de ce réputé « intraduisible » chef-d’œuvre de la littérature italienne de quelque trois millions de signes a débuté en 2012 avec Monique Baccelli pour les éditions de Benoît Virot, Le Nouvel Attila. Avec le CITL c’est une grande histoire. En 2013, j’ai participé à la Fabrique des traducteurs espagnole, et la même année, dans le cadre des 30es Assises de la traduction littéraire qui avaient pour thème « Traduire la mer », nous avons tous les trois eu la chance d’être invités à mener une table ronde sur ce projet – « Rencontre avec un livre Léviathan ». À cette occasion, une lecture bilingue a été donnée par Carlotta Viscovo et Jörn Cambreleng. C’était la première fois que nous pouvions entendre notre traduction et surtout la confronter à l’écoute de professionnels et de lecteurs. Ce soir, une nouvelle occasion de faire résonner le texte m’est donnée et ce sont des étapes essentielles pour avancer.
CITL : Où en êtes-vous aujourd’hui, quelle est votre méthode de travail avec Monique Baccelli et quelles sont les principales difficultés ?
A. W. : Le travail s’est réparti naturellement selon les domaines où chacun se sentait le plus à l’aise : dans un premier temps, chacun travaillait sur le premier jet et nous comparions nos versions, puis c’est Monique Baccelli qui s’est chargée en grande partie du premier jet global et moi je me suis occupé plus systématiquement de la phase de révision poussée, c’est-à-dire des différentes recherches lexicologique, historique et culturelle et des propositions de remaniement du texte. Aujourd’hui, le premier jet est quasiment achevé et la révision de la première moitié du roman sera terminée fin décembre. En gros, il nous reste encore près de deux ans de travail. Nous avons déjà bien défriché et nous devrions pouvoir aller plus vite.
Pour ce qui est des difficultés, je dirai qu’il y en a à tous les niveaux du projet ! Pour ce qui est de la traduction à proprement parler, il faut savoir que Stefano D’Arrigo a mis 15 ans à écrire son livre puis a passé 10 ans à retravailler les épreuves de cette première version ! Et nous n’avons pas ce temps-là pour la version française. Il est passé de 660 pages à 1240 pages en italianisant le dialecte sicilien du détroit de Messine des années 40 en passant par le bain gréco-romain et différentes étapes archaïques de l’italien. Il a donc créé une langue très homogène en fusionnant toutes ces couches de langage, un véritable dialecte darrighien ! Même les italiens ne comprennent pas tout, mais la patine du texte en permet l’accès le plus souvent. Avec une telle homogénéisation nous aurions pu choisir de traduire ce texte en ne conservant que le sens mais nous aurions perdu l’essence de cette langue qui fait de ce roman un monument littéraire. Notre difficulté c’est d’avoir refusé cela et d’avoir choisi de traduire avec la plus grande liberté tout en restant très proches de la langue et du style de l’auteur. De toute façon, il y a des systématismes de l’auteur qui ne nous le permettaient pas. D’Arrigo agit très souvent aussi bien au niveau des mots, des expressions que des références textuelles. Il peut filer une métaphore à partir d’un des sens contenus dans l’étymologie d’un mot. En français, nous sommes tenus d’en tenir compte et de procéder à la même recherche. De plus Horcynus Orca est un poème en prose de plus de mille pages, une vision mythique se met en place par la réactualisation mythologique d’une culture en train de se perdre après la destruction de la seconde guerre mondiale. C’est un des thèmes du livre. Ce roman est une odyssée, l’histoire d’un retour impossible, il y a des références directes aux grands textes de la mythologie gréco-latine. La musicalité – au niveau de la syntaxe, des répétitions, des assonances – et la structure même du roman qui reprend la figure du ressassement, tel le détroit de Messine habité par les courants marins, ont été travaillées au plus haut point par D’Arrigo, c’est vertigineux. Aussi cette musicalité et ce souffle donné à la langue sont une priorité dans notre travail, d’où l’importance des lectures face à un public. Le travail de révision est donc très poussé comme je le disais : en plus des recherches historiques sur l’Italie et la culture sicilienne, il y a l’univers lexical spécifique à la pêche et au monde marin qu’il m’a fallu acquérir. Dans cette aventure, je me suis découvert une véritable passion pour la lecture des dictionnaires ! Je me prends parfois pour un archéologue marin ! La tentation de tout lire me tenaille mais c’est tout simplement impossible ! Il faut accepter d’avancer même si nous n’arrivons pas à résoudre chaque difficulté du texte et faire confiance à la langue française qui reste proche de l’italien. Parfois, elle nous surprend en nous offrant de par ses qualités intrinsèques une solution différée. Il y a aussi des moments de magie dans le travail, cela s’est produit par exemple avec le mot « fera » que l’auteur a choisi pour désigner le dauphin. Son origine latine est « fiera » qui signifie bête féroce. Je n’ai retrouvé nulle part cet emploi de « fera » en italien, nous avons donc cru à une invention de l’auteur et en français nous avons choisi de conserver cette forme en traduisant par « la fère ». C’est en faisant des recherches que je suis tombé bien plus tard sur cet emploi chez un naturaliste français du XIXe siècle ! Nous n’avions rien inventé ! Ainsi pour être fidèle à la langue de l’auteur, nous utilisons également toutes les ressources de la langue française à notre disposition – le moyen français, le français du XVIIe siècle ou encore le provençal –, quitte à tordre certains mots comme a pu le faire D’Arrigo pourvu que cela sonne juste. Il faut aussi constamment chercher un équilibre entre les formes archaïques, les néologismes et la langue courante, orale et littéraire.
CITL : Dans ce travail vous affrontez une mer immense, comment vivez-vous cette traduction ?
A. W. : Je pense qu’il nous reste deux ans de travail et depuis trois ans je n’ai guère pu me consacrer à d’autres projets. Alors c’est vrai que je me sens parfois totalement absorbé mais je savoure aussi l’émerveillement que ce texte me procure régulièrement. C’est paradoxal, j’ai à la fois envie et peur de finir. Je sens que la traduction de ce texte sera une expérience unique dans ma vie de traducteur et j’espère pouvoir goûter d’autres grands textes.
Avant la lecture de ce soir, voici un extrait plus ou moins autonome, qui illustrera je l’espère le propos. Il a été très compliqué de faire une citation courte… tout est tellement relié !
C’était un après-midi de soleil et un peu de mistral soufflait, un peu, juste ce qu’il fallait pour maintenir enjouée et crépitante la vague en surface. Vers Casablanca, ils avaient repéré un petit banc de fères. De loin, elles semblaient se la couler douce comme à leur habitude quand elles sont repues, leur sac à merde d’estomac rempli à ras bord d’une rengaine de sardines. Qu’on se figure les berlues qu’ils se sont faites, les voyant de loin nager et voler, faire de cette manière les bazardeuses, tout un nagevolement dans un grand écumement toujours à la ronde dans une même mer. En s’approchant, ils virent pourtant qu’elles se lançaient quelque chose, on ne comprenait pas quoi : mais une chose que ces boute-en-train utilisaient comme une balle, la lançant dans les airs, sautant derrière, la laissant tomber à l’eau et plongeant toutes ensemble pour la repêcher et se chamaillant pour la repêcher chacune avant les autres, dans des mêlées échevelées et écumantes, parmi les contorsions et les volées des queues et des becs qui pointaient dans les airs, lançant des petits rires dentus.
Poussés par la curiosité, ils s’étaient rapprochés de ce coin et les fères, si elles ne s’en étaient pas avisé, depuis Dieu sait combien de temps, avaient alors lancé cette espèce de balle plus loin, sans cesser pourtant leur pasquinade, déménageant simplement de ce point de mer : dans cette mer qu’elles avaient dégagée de leur présence, apparut alors à leurs yeux le requin et ils comprirent, en le voyant, que c’était sa queue, cette affaire qu’elles se lançaient.
Era un pomeriggio di sole e soffiava un poco di maestrale, poco, quanto bastava per mantenere allegrotta e scoppiettante l’onda di superficie. Verso Casablanca, avevano avvistato un piccolo branco di fere. Di lontano, pareva se la sciacquettassero come stilano quando sono sazie, col sacco di merda dello stomaco pieno sino all’orlo di cantari di sarde. Figurarsi che abbaglio avevano pigliato, vedendole di lontano nuotare e voliare, fare a quel modo le baraondose, tutte un nuovoliare in un grande schiumeggiare intorno intorno sempre in un medesmo mare. Avvicinandosi, videro però che si palleggiavano qualcosa, non si capiva cosa: qualcosa però, che quelle sciampagnone trattavano come una palla, lanciandola per aria, saltandole dietro, lasciandola cadere in acqua e tuffandosi tutte insieme a ripigliarla e accapigliandosi a ripigliarla ognuna prima delle altre, in mischie arruffate e schiumeggianti, fra contorsioni e sventagliate di code e becchi che si puntavano per aria, gettando risolini di denti.
Spinti dalla curiosità, erano andati accostando da quella parte e le fere, che se n’erano scandaliate chissà da quanto tempo, avevano allora lanciato quella specie di palla più in là, senza smettere però la pomponella, spostandosi solo di mare: in quel punto di mare che esse avevano sgomberato della loro presenza, apparve allora ai loro occhi il verdone e capirono, vedendolo, che era la sua coda quell’affare che si palleggiavano.
Horcynus Orca, Rizzoli, 2003, p. 368.
// Biobliographies //
Stefano D’Arrigo (Alì Terme/Messina, 1919 – Roma, 1992)
Joueur de football dans sa jeunesse, acteur épisodique – en 1961 il joue un petit rôle dans le premier film de Pasolini, Accattone –, poète et critique d’art, le jeune homme soutient une thèse sur Hölderlin en 1942 avant de partir à la guerre. Il devient dans les années 70 un écrivain atypique, connu essentiellement pour son roman monumental de quelques 1270 pages, Horcynus Orca, dont la première mouture (660 pages) fut intitulée I fatti della fera. Après avoir publié en 1957 un recueil de poèmes, Codice siciliano, il a travaillé sans interruption à son œuvre majeure, qui ne fut publiée dans son intégralité qu’en 1975. Le roman reçut un accueil enthousiaste pour son audace narrative et pour la richesse de la langue et du style. Réimprimé en 1982, souvent repris comme sujet d’étude, il représente un sommet de la recherche littéraire des dernières décennies du XXe siècle. L’autre roman de D’Arrigo, l’étrange Cima delle nobildonne (1985), pour lequel il reçut le prix Elsa Morante, se situe aux antipodes par sa brièveté et par la densité de son écriture.
Monique Baccelli
Née en 1930 à Paris, Monique Baccelli soutient une thèse en Sorbonne sur Landolfi et les romantiques allemands, et collabore entre autres aux revues NRF, Europe, La Quinzaine littéraire, Les Lettres françaises, Testo a fronte, Nuova Italia. Depuis 1986, elle a traduit plus d’une centaine de livres et un vaste éventail d’auteurs anciens et contemporains, de la prose comme de la poésie et des essais, en particulier Alfieri, Leopardi, Pirandello, Fenoglio, Landolfi, Alvaro, Gadda, Palazzeschi, Malerba, Solmi, Rigoni Stern, Tomasi di Lampedusa, Savinio, Cavazzoni. Elle a reçu en 2008 le prix Sévigné pour la Correspondance intégrale de Giacomo Leopardi.
Antonio Werli
Antonio Werli est né en Alsace en 1980. Après une matinée passée en Lettres Modernes, il a une révélation : ce sera la dernière. La fortune le mène alors en librairie où il officie douze années et devient un lecteur assidu de littératures étrangères. En parallèle, il pilote la revue Cyclocosmia, dont les trois numéros sont respectivement consacrés à Thomas Pynchon (2008), José Lezama (2009) et Roberto Bolaño (2010). Il est aussi l’un des fondateurs du Fric Frac Club, site de critique littéraire en ligne depuis 2005 et qui continue l’esprit de la revue Cyclocosmia arrêtée en 2010. C’est dans ces entreprises éditoriales qu’il commence à traduire.
Cabriolant entre espagnol et italien, entre Buenos Aires et les Abruzzes, il a fait, aux derniers jours de 2012, l’irresponsable serment de gagner sa vie en ne traduisant que des micro-fictions échevelées ou des terrorisants romans-monstres. Les Aventures d’un romancier atonal de l’Argentin Alberto Laiseca paraît aux éditions Attila en 2013. Il traduit aujourd’hui avec Monique Baccelli pour Le Nouvel Attila Horcynus Orca de l’italien Stefano D’Arrigo.